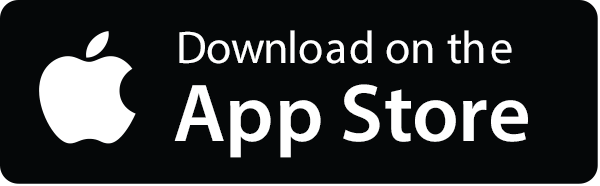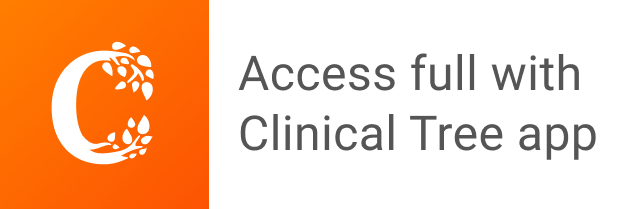Abstract
Objectives
After several decades of stability, polio survivors often experience new signs and symptoms of their condition, characterized by global and muscular fatigue, decreased muscular strength and pain. The hypothesis of a potential underlying psychological component has been suggested.
Method
This article aims to report how polio survivors cope with their condition based on an analysis of the literature and the authors’ experience.
Results
The literature does not report a higher prevalence of psychological disorders (mood disorders, depression) in polio survivors than in the general population. Conversely, the psychological impact of the patients’ decreasing abilities, regardless of the cause, is regularly reported. Most patients report a restricted involvement in their daily life activities.
Discussion and conclusion
It is essential to be aware of the patients’ experience in coping with polio as children as well as the medical treatments they went through in order to better understand their various types of complaints and sometimes their reluctance to go back to a medical environment. With such widespread information on post-polio syndrome (PPS) and all the uncertainties surrounding it, patients fear a late onset deterioration of their condition. In order to provide the best therapeutic advice, it is essential to have a good knowledge of the symptoms but also take the time and listen to patients in order to differentiate the underlying physical and psychological components in symptoms of pain and fatigue.
Résumé
Objectifs
Les personnes vivant avec des séquelles de poliomyélite ressentent souvent, après des décennies de stabilité, une aggravation secondaire pouvant se traduire par une fatigue générale et musculaire, une baisse de force musculaire et des douleurs. La composante psychologique de ces symptômes a pu être envisagée.
Méthode
Cet article fait le point sur le vécu de ces personnes à partir de la littérature et de l’expérience des auteurs.
Résultats
La littérature ne montre pas chez les anciens polio de fréquence plus grande de troubles psychiques (troubles de la personnalité, dépression) que dans la population générale. En revanche, le retentissement psychique de la diminution des performances, qu’elle qu’en soit la cause, est régulièrement rapportée. Une majorité d’entre eux rapporte une restriction de leur capacité de participation.
Discussion et conclusion
Les caractéristiques du parcours souvent vécu par ces patients dans leur enfance doivent être connues pour comprendre les différentes possibilités d’expression de leurs plaintes et parfois la réticence à faire appel à nouveau au milieu médical. La crainte de la réviviscence de la maladie est avivée par les informations largement répandues sur le syndrome post-poliomyélite (SPP) et plus encore par les incertitudes le concernant. Il faut du temps, écoute et connaissances pour démêler si possible les différentes composantes physiques et psychiques des symptômes de fatigue et de douleurs afin de donner les meilleurs conseils thérapeutiques.
1
English version
1.1
Introduction
Post-polio syndrome (PPS) is a condition defined by the onset of new neuromuscular symptoms that affect polio survivors, years after recovering from an initial acute attack of the poliomyelitis virus, usually responsible for paralysis sequelae. These sequelae and their concomitant functional symptoms stayed stable for several decades. After years of stability during which the prevalence of general diseases was not different than that of the general population , the patient feels a new weakening in muscles that were previously affected by the polio infection and in muscles that were seemingly unaffected. Symptoms include slow and progressive muscle weakness, unaccustomed fatigue (both generalized and muscular), as well as pain affecting the muscles, joints and tendon insertion points . A study was conducted on 260 polio survivors 40 years after their initial attack which usually occurred around the age of five. Out of these 260 patients who answered a questionnaire, 58% of them perceived their health status to be bad, especially in those affected by late setting deterioration with neuromuscular symptoms . Sometimes, the hypothesis of a chronic inflammatory process being reactivated is being brought up when faced with some biological abnormalities (not specified) and the efficacy, even quite relative, of some immunoglobulin treatments. The reported prevalence of this syndrome differs according to various studies going from 20% to 31% or 36% ; showing how badly understood the nosological and semiological aspects of this syndrome are. In fact, PPS does not sum up all the possible complaints of patients with polio sequelae, or “polio survivors” as we will call these patients in order to avoid any confusion with PPS. Each symptom described by the patient must benefit from an individual and unique etiological study . None of the PPS symptoms are polio-specific except the aggravation of the motor deficit validated by a physician and when other causes have been discarded. The symptoms of fatigue, of any type, and pain are largely encountered in the general population. They have the same physical and/or psychological origins and can have a strong psychological impact on patients. The term fibromyalgia that we see mentioned as one of PPS symptoms does not help , however it shows how a patient’s physical and psychological sides are strongly entangled, a natural evidence that is too often overlooked.
Before vaccination became available, fighting the acute disease and limiting its sequelae monopolized the entire medical attention. The issue of coping with motor deficits, in spite of their health consequences, was considered almost out of the medical framework as it is often the case with several other affections. The speciality of physical medicine and rehabilitation has been implemented and developed in part to answer the great needs of children affected by various degrees of paralysis, sometimes the cases were quite dramatic. Later on, when these adult polio survivors reported symptoms of fatigue and muscular weakness, physicians sometimes related them to “simple” psychological disorders, by carelessness or lack of knowledge. The effects of PPS were often interpreted as depressive symptoms or patients refusing to cope with the natural aging process.
There is no univocal answer to whether anxiety and depression are secondary to functional deterioration or if they are the cause. We will only try to bring some insights to the life experience of polio survivors, through literature but also by bringing up our 15-year clinical experience of post-polio consultations in over 500 polio survivors at the Raymond Poincaré Hospital (Garches) and at the Fernand Widal Hospital (Paris), mainly in the context of the Île de France polio network implemented by Pr Olivier Dizien, M.D. † with Philippe Denormandie, M.D.
1.2
Psychological suffering
1.2.1
Depression
The prevalence of depressive symptoms in polio survivors varies greatly according to the studies. Conrady et al. reported the highest percentage of somatic symptoms and depression . Their study included a cohort of 93 polio survivors in the USA (San Francisco), and compared 71 of them consulting for various psychological disorders to 22 others among a group of polio survivors receiving disability payments for polio sequelae but without any particular complaint. These authors did not find any difference in percentages of physical (mainly fatigue, muscular weakness and pain) or psychological complaints between both groups, but they reported a high percentage of depression, irritability and anxiety amounting to about 50% in both groups. On the one hand, Hazendonk and Crowe in Australia comparing a cohort of 23 patients with PPS to 20 patients without PPS and 22 patients in a control group, noticed a higher percentage of depression and hypochondriac syndrome in the PPS group . On the other hand, Tate et al. only reported 15.8% of patients showing symptoms of depression among a stratified sample group of 116 polio survivors in the USA (Michigan) among a population of 425 individuals who answered the study questionnaire . The depressed patients reported a more severe physical deterioration, more pain with a higher rate of somatic complaints, a lower coping behavior, a lesser quality of life and frequent loneliness. But these authors only showed the link between depression and the feeling of being sick, without being able to validate a causal relationship with poliomyelitis sequelae. Finally, in a more recent study, Kemp et al. recruited a cohort of 121 polio survivors in the USA (Rancho Los Amigos Medical Center, California), among beneficiaries of disability payments. Symptoms of depression were reported in 28.2% of polio survivors versus 17.9% in the control group. The authors showed that the risk factors were obviously the physical changes linked to their polio sequelae, but even more so the quality of the support brought on by their family and loved ones as well as their own attitude towards their disability. Overall, this percentage does not seem different than the one from the general population and when the pathophysiological characteristics of polio survivors suffering from PPS were studied, mainly their personality, these characteristics did not seem any different than the ones from the general population .
1.2.2
Fatigue
Physical fatigue is a constant symptom of PPS. However, what is the part attributed to neuromuscular exhaustion and the one to a potential depressive state? In a North American study (San Francisco, USA) conducted on 86 polio survivors versus 20 individuals in a control group and focusing mainly on fatigue, Berlly et al. did not report a difference in general fatigue characteristics, but however they noted wide differences in physical fatigue (muscular heaviness…). Schanke et al. observed in 118 out of 266 polio survivors in Norway that when there is a generalized and intense fatigue. It is mainly linked to psychological symptoms rather than physical ones, without however noting more depressive symptoms. An interesting hypothesis is that psychological fatigue reported by several patients and some authors could have a pathophysiological component related to the lesions of the reticulating activating system, as observed with MRI in 55% of patients suffering from severe PPS. These patients were especially affected by attention disorders, difficulties in concentrating and even recent memory and consciousness disorders, even if they did not report any changes in their cognitive abilities . These symptoms of mental fatigue did not seem to be related to the depressive symptoms. Nevertheless, in a contradictory manner, these memory and attention performances were not reported as being different by Hazendonk and Crowe . According to the most recent study of Ostlund et al. conducted on 143 Norwegian polio survivors, the patient’s vitality (defined by the presence of energy and lack of fatigue) seems to essentially depend on physical factors and not on psychological fatigue.
Thus, according to the way we look at the question, it is quite possible to come to different conclusions. It is necessary to proceed with great caution taking into account the great contradictions found in the literature and the doubtful quality of the methodology in the few studies that are available. The diagnosis criteria for PPS are often poorly described, control groups are very small and by comparing studies from different countries, there is a risk of not comprehending cultural and social factors that are nevertheless essential.
1.3
Life experience and restricted participation (social impairments)
It is important to bring up some characteristics of the life experience of polio survivors. When asked, these patients complain of greater deterioration of their physical and/or psychological condition with a negative impact on their ability to participate in social activities. An increase in social impairments was reported in Sweden, but only in patients with PPS . Very recently in this same country, Lund and Lexell showed that 35% of the 165 polio survivors who filled out a questionnaire, felt they experienced one to six severe participation impairments, the highest ranked were access to leisure activities, work, their place and role within the family and access to education . In another study conducted in The Netherlands on a cohort of 233 polio survivors, 53% of them reported impairment in their social life . In France, the Groupement de Liaison et d’Information sur la Poliomyélite (GLIP) (Liaison and Information Network on Poliomyelitis) conducted a study on their members for the first French-speaking countries conference on poliomyelitis that was held in Paris in 2006 . This study clearly unveiled four major issues: “The fear to see their spouse, able-bodied or disabled, facing a health problem and not being able to deal with it; the difficulty to cope with an aggravated loss of autonomy; the feeling of being treated like a child; the lack of comprehension and attention that can lead to depression”.
To understand what questions polio survivors ask themselves and the ones they want answers to, we need to understand what their life experience was.
1.4
Childhood
Poliomyelitis, often contracted in early childhood, has a definite impact on these patients’ lives, even more so if the acute disease was severe and they had to stay in the hospital for long periods of time.
Often affecting children under the age of two, this period of the acute disease probably did not leave many conscious thoughts. The first objective memories patients remember, a little later on, are the ones highlighting their differences with other children: necessity to wear orthotic devices or braces, inability to play sports like other kids, sometimes even the need to attend school at the hospital. The relationships with the medical teams, especially if several surgeries were necessary, bring their burden of physical pain and always confront the patients to their difference. For many children, these long years spent in a hospital setting leave a strong imprint in their mind, and later on, they will do their best to avoid any further contact with the medical field. Several parameters had an impact on their life experience growing up in a medical environment: close relationship with family members, their presence, the family structure, the way they lived and behaved with children in relation to their physical disability, sometimes by overprotecting them, most often by fighting for their children to be just like others. These children experience was particularly traumatizing as they were being taken away from their home setting for months or even years of hospitalization. Abandonment anxiety, fear of death (common rooms with iron lungs in which children were dying and could see others dying as well) and sometimes even physical abuse were awful daily companions for these children.
Children impaired by their paralysis will learn to leave with their disability, within a social environment where individuals only tolerates difference as long as it does not affect their own life. Disabled children must make an effort to adapt to this social context or leave it. Situation where children had to stay away from the group were recurrent, sometimes due to an objective inability to join in, but other times only based on purely hurtful decisions. Children growing up with physical disabilities, not just polio, who had a proper family and social support, often built-up strong personalities and are used to give their very best to be just like others.
1.5
Cutting the umbilical cord a second time around
When the growth period comes to an end, it is time to give up and store away these cumbersome and ugly chest braces, orthotics and orthopedic shoes, always reminding patients and others around them of their physical differences. Giving up these orthotic devices was sometimes only been possible by taking some assumed risks and doing physical acrobatics. On a pronounced scoliosis where the patient wore a very constraining chest brace and then had surgical fixation, freeing patients from all these constraints is possible most of the time. It is a key period, cutting the umbilical cord a second time around, the one linking the patient to the medical and family environment.
Once an adult, the former child has been able to lead a very intense professional life, in spite of or because of his or her disability, a woman could fulfill her desire for children and have uncomplicated pregnancies and births. Many polio survivors have had active and fulfilling lives without ever requiring any medical help until the embarrassing disorders came up: falls, loss of muscular strength, trauma destabilizing a fragile equilibrium, arthritis on overworked joints… Of course having had polio obviously does not protect against other diseases. Furthermore, there is a constant intricacy between the consequences of post-polio paralysis and other health disorders. No one forgets polio and unfortunately, it can too often be accused of all ills, sometimes by carelessness or lack of knowledge.
However, paradoxically, some patients are not able to “cut the cord” with older practices and some of them even behave as if they “refuse” or “are not being able” to grow up: the physiotherapist is never competent because he or she uses different techniques than the ones they had when they were children, the orthotic specialist is incapable of finding the right orthosis and the physician knows nothing about this disorder…
1.6
Late functional deterioration
These patients are obviously very anxious of experiencing physical deterioration again. Physical deterioration due to physiological aging is difficult to accept, furthermore because it often leads to new indications for orthotics. Sometimes, wearing again orthotics on the lower limbs can be the only way to enable the patient to walk without any risk of falling, fatigue or exaggerated joint alteration… but it is obviously very complicated to deal with for these patients. The anxiety of going through physical deterioration is naturally always there. Nowadays, orthotic devices are thankfully lighter than the “leather/metal” ones used in the past, but they are still quite constraining and stigmatizing for some patients. Besides prescribing new orthotic devices, one of the main difficulties encountered by a physician is to convince these patients that rehabilitation at the age of 60 is obviously very different than the one they experienced as children: muscle reinforcement techniques are different, and energy conservation measures are as essential if not more than muscle reinforcement… Patients come back to us with much apprehension, they find familiar elements in our language and the way we conduct our examinations but they do not understand our recommendations that are completely different than the ones they were thought during their childhood.
This late setting deterioration due to new signs and symptoms of the disease is source of many worries for these patients, greatly promoted by the knowledge and uncertainties surrounding the PPS. It probably leads to an overestimate of the prevalence of PPS again since most of its symptoms are not polio-specific. What is the part played by poliomyelitis, lifestyle, natural physiological constitution, new health disorders or natural aging? This question must systematically be studied for each patient.
But when the restrictions and constraints in childhood were quite heavy, confronting again the medical world and returning to the hospital brings back bad childhood memories with strong and anxiety-filled emotions. Trust and apprehension are often intertwined. The first human medical contact after 30 or 40 years can be decisive. Reliving detailed clinical examinations like “in the old times”, with muscular testing and joint goniometry can bring back unbearable life experiences.
1.7
Conclusion
If there are common characteristics to all polio survivors, we must avoid drawing any simplistic clinical picture. Polio is responsible for various types of paralysis, always different from one person to the next. It is only one of the parameters that contributed to building the patient’s personality and psychological traits.
In severe cases, the memory is still vivid for these patients with all these long years of schooling surrounded by constant medical attention, an ostracizing disability that kept them from social groups, and major physical constraints. Because of deep-set physical and psychological pain, patients are sometimes greatly afraid of any medical procedure. Behind the patients’ complaints, the fears and suffering from their childhood are never far away. Their hope and suspicion towards medical professionals can lead to misinterpreting some of their behaviors.
It is essential to have the knowledge but also take time and listen to our patients to untangle the different elements making up the symptoms of fatigue and pain. Inciting these patients to seek psychological support is often quite useful; it will be the basis to the right therapeutic choice between treatments (rehabilitation, orthotics, medications, surgery) or a necessary abstention of treatment.
2
Version française
Le syndrome post-poliomyélitique (SPP) est défini par l’apparition de nouveaux symptômes neuromusculaires chez un patient ayant développé des années auparavant la poliomyélite, habituellement responsable de paralysies séquellaires. Ces paralysies et leur retentissement fonctionnel sont restés stables pendant une période de plusieurs décades. Après cette période de stabilité au cours de laquelle la fréquence des maladies générales n’est pas différente de celle de la population générale , le patient ressent une forte dégradation fonctionnelle associant, dans un tableau complet, à l’apparition de déficit moteur sur des muscles apparemment sains, l’aggravation de déficits existant, une fatigue musculaire accrue, une fatigue parfois générale et des douleurs touchant les muscles, les insertions tendineuses et les articulations . Quarante ans après la poliomyélite contractée en moyenne à l’âge de cinq ans, la perception de leur état de santé est exprimée comme étant mauvaise par 58 % des 260 personnes répondant à un questionnaire, particulièrement chez ceux présentant des symptômes neuromusculaires tardifs . La question de la réactivation d’un processus inflammatoire chronique est évoquée devant l’observation de certaines anomalies biologiques (toutefois non spécifiques) et l’efficacité même toute relative de certains traitements par immunoglobuline. La fréquence de ce syndrome est diversement appréciée selon les études, allant par exemple de 20 % à 31 % ou 36 % , montrant bien par-là les incertitudes nosologiques et sémiologiques. Car ce syndrome ne résume évidemment pas toutes les plaintes possibles d’un patient porteur de séquelles de poliomyélite, le « sujet polio » comme nous l’appellerons pour éviter toute confusion avec le SPP. Chaque symptôme décrit par le patient doit faire l’objet d’une enquête étiologique propre . Aucun des éléments du SPP n’est spécifique de la poliomyélite, à l’exception de l’aggravation du déficit moteur lorsqu’elle est avérée et lorsque d’autres causes ont été éliminées. La fatigue, quelle qu’elle soit ainsi que les douleurs sont largement rencontrées dans la population générale. Elles ont elles-mêmes des origines physiques et/ou psychologiques et peuvent avoir un fort retentissement psychologique. L’appellation de fibromyalgie que l’on voit apparaître dans le cadre de ce SPP ne simplifie d’ailleurs rien , la forte intrication entre le physique et le psychique, évidence naturelle trop souvent oubliée, n’en est que mieux mise en valeur.
Avant la vaccination, le combat pour la maladie aiguë et la limitation de ses séquelles occupaient toute la réflexion médicale. Vivre avec les séquelles motrices, malgré leurs conséquences sur la santé, sortait pratiquement du champ de la médecine, comme cela est d’ailleurs encore trop souvent le cas dans de nombreuses affections. La spécialité de médecine physique et de réadaptation s’est notamment développée pour répondre à ces grands besoins face aux problèmes posés par la croissance d’enfants paralysés à des degrés divers et de façon parfois dramatique. Plus tard, les manifestations de fatigue et de faiblesse rapportées par les patients devenus adultes ont pu être, par facilité ou méconnaissance, rapportées à de « simples » préoccupations psychologiques. Les effets ressentis du SPP ont été souvent interprétés comme des signes de dépression ou de refus de vieillissement.
Nous n’apporterons pas ici de réponse univoque à la question de savoir si l’anxiété et la dépression sont secondaires à la dégradation fonctionnelle ou si elles en sont à l’origine. Nous tenterons seulement d’apporter des éléments de compréhension de ce que vivent les patients polio, au travers de la littérature et de notre expérience de 15 ans de consultations post-polio portant sur plus de 500 patients à l’hôpital Raymond-Poincaré (Garches) et à l’hôpital Fernand-Widal (Paris), notamment dans le cadre du réseau polio Île de France monté par le Pr Olivier Dizien † avec le Dr Philippe Denormandie.
2.1
Souffrance psychique
2.1.1
Dépression
La fréquence de symptômes de dépression chez les patients porteurs de séquelles de poliomyélite est très différemment observée selon les études. Conrady et al. sont les auteurs ayant noté le plus fort pourcentage de symptômes de somatisation et de dépression. Étudiant 93 patients polio aux États-Unis (San Francisco), ces auteurs avaient comparé 71 d’entre eux qui consultaient pour divers problèmes d’ordre psychologique à 22 autres parmi un groupe de personnes indemnisées pour séquelles de poliomyélite mais sans plainte particulière. Ces auteurs ne constataient pas de différence dans le pourcentage des plaintes physiques (fatigue, faiblesse musculaire et douleurs principalement) ou psychologiques, mais un fort pourcentage de dépression, irritabilité et anxiété avoisinant 50 % dans les deux groupes. Dans une population australienne de 23 patients présentant le SPP comparés à 20 patients polio sans SPP et à 22 sujets témoins, Hazendonk et Crowe constataient aussi un pourcentage plus élevé de dépression et de syndrome hypochondriaque dans le groupe SPP. À l’opposé, Tate et al. ne constataient que 15,8 % de patients présentant des signes de dépression au sein d’un échantillon stratifié de 116 sujets polio aux États-Unis (Michigan) parmi une population de 425 sujets ayant répondu à une proposition d’enquête. Les sujets déprimés accusaient une plus grande détérioration physique, plus de douleurs avec un taux plus élevé de plaintes somatiques, une combativité ( coping behaviour ) inférieure, une moins bonne qualité de vie et une fréquente solitude. Mais ces auteurs ne faisaient que montrer le lien entre dépression et le sentiment d’être en mauvaise santé, sans pouvoir conclure sur les liens de causalité avec la poliomyélite. Enfin, dans une étude plus récente, Kemp et al. étudiaient 121 sujets polio aux États-Unis (Rancho Los Amigos Medical center Californie), recrutés parmi des bénéficiaires d’allocation. Des symptômes de dépression étaient présents chez 28,2 % d’entre eux contre 17,9 % d’une population témoin. Ces auteurs montraient que les facteurs de risque étaient, certes, les modifications physiques en rapport avec leurs séquelles de poliomyélite, mais plus encore la qualité de l’entourage familial et leur comportement personnel (attitude) vis-à-vis du handicap. Au total, ce pourcentage ne semble pas différent de celui de la population générale et lorsque les caractéristiques psychopathologiques des patients souffrant de SPP ont été étudiées, notamment la personnalité, elles ne paraissaient pas différentes de celles de la norme de la population générale .
2.1.2
Fatigue
La fatigue physique est une constante dans le SPP. Mais quelle est la part de l’épuisement neuromusculaire ou de l’éventuelle dépression ? Dans une étude aux États-Unis (San Francisco) portant particulièrement sur la fatigue, chez 86 « anciens polio » comparés à 20 sujets témoins, Berlly et al. ne notaient pas de différence dans les caractéristiques de la fatigue générale, mais de grandes différences dans la fatigue physique (lourdeur musculaire…). Schanke et al. ont eux observé chez 118 parmi 266 sujets polio en Norvège que lorsque la fatigue générale est présente et intense, elle est principalement reliée à des manifestations psychologiques plus que physiques, sans pour autant observer plus de symptômes dépressifs. Une hypothèse intéressante est que la fatigue mentale rapportée par de nombreux patients et certains auteurs pourrait avoir une composante physiopathologique en rapport avec des lésions du système réticulé activateur, telles qu’elles ont pu être observées en IRM chez 55 % de patients souffrant d’un SPP sévère. Ces patients souffraient particulièrement de troubles attentionnels, de difficultés de concentration et même de troubles de la mémoire récente et de l’éveil mais n’exprimaient pas d’altération de leurs capacités cognitives . Ces symptômes de fatigue mentale ne paraissaient pas liés à ceux de dépression. Néanmoins, de façon contradictoire, ces performances de mémoire et d’attention n’ont pas été retrouvées différentes par Hazendonk et Crowe . Selon l’étude toute récente d’Ostlund et al. auprès de 143 sujets polio en Norvège, le phénomène de vitalité (défini par la présence d’énergie et l’absence de fatigue) semble bien être essentiellement dépendant de facteurs physiques et non en relation avec une fatigue mentale.
Ainsi, selon la manière d’aborder la question, il n’est pas impossible d’aboutir à des conclusions différentes. La plus grande prudence s’impose, compte tenu de très grandes contradictions retrouvées dans la littérature et de la qualité souvent discutable de méthodologie des rares études disponibles. Les critères même de diagnostic du SPP sont souvent peu décrits, les groupes témoins sont le plus souvent très petits et la comparaison d’études faites dans des pays différents risque de faire méconnaître des facteurs culturels et sociaux pourtant essentiels.
2.2
Vécu et restriction de participation (handicaps sociaux)
Il faut rappeler ici certaines caractéristiques du vécu des patients polio. Lorsqu’ils sont interrogés, ces patients accusent une plus grande détérioration de leur condition physique et/ou de leur condition psychique avec un fort retentissement sur leur capacité de participation. Une augmentation de handicaps sociaux a été rapportée en Suède, mais uniquement chez les patients présentant un SPP . Tout récemment dans ce même pays, Lund et Lexell ont rapporté que 35 % des 165 sujets polio ayant répondu à un questionnaire percevaient d’un à six problèmes sévères de participation, au premier rang desquels l’accès aux loisirs, au travail, leur rôle familial et l’accès à l’éducation . Dans une autre étude aux Pays-Bas, 53 % d’une population de 233 sujets polio accusaient un handicap dans leur vie sociale . L’enquête faite en France par le groupement de liaison et d’information sur la poliomyélite (GLIP) auprès de ses adhérents pour le premier congrès francophone sur la poliomyélite tenu à Paris en 2006 révélait clairement quatre préoccupations majeures : « la crainte de voir son conjoint valide ou non, confronté aussi à un problème de santé et de ne pas pouvoir faire face ; la difficulté de vivre la perte d’autonomie aggravée ; le sentiment d’être infantilisé ; le manque de compréhension et d’écoute pouvant amener à la dépression ».
Pour comprendre les questions que posent et que se posent les sujets polio, il faut comprendre quel a été leur parcours de vie.
2.3
L’enfance
La poliomyélite, le plus souvent contractée dans la toute petite enfance, imprime définitivement la vie, d’autant que la maladie a pu être sévère et l’hospitalisation longue.
Souvent contractée avant deux ans, cette période de la maladie aiguë ne laisse sans doute pas de trace bien consciente. Les souvenirs objectifs, un peu plus tardifs, sont ceux de la différence avec les autres enfants : obligation de porter des appareils ou des corsets, impossibilité de faire du sport comme les autres, obligation parfois faite de suivre une scolarité en milieu hospitalier. Les rapports avec le milieu médical, surtout si différentes opérations ont été nécessaires, apportent leur lot de souffrance physique et renvoient toujours à la différence. Pour de nombreux enfants, ces longues années passées en milieu hospitalier laissent une empreinte forte, qui leur fera souvent éviter autant que possible tout contact ultérieur avec ce milieu. Dans le vécu de ces années de croissance encadrée, de nombreux paramètres ont joué : la famille proche, son existence, la structure, la façon de vivre et de faire vivre par l’enfant le handicap physique, parfois dans la surprotection, plus souvent par la valorisation du combat pour être comme les autres. La rupture avec le milieu familial, imposée par des mois, voire des années d’hospitalisation, a été souvent particulièrement traumatisante. Angoisse d’abandon, peur de la mort (salles communes avec des poumons d’acier dans lesquels les enfants mourraient et voyaient mourir les autres) et parfois même maltraitance ont été de bien terribles compagnes.
L’enfant handicapé par ses paralysies apprendra à vivre malgré son handicap, dans des groupes sociaux qui, le plus souvent, ne tolèrent la différence que dans la mesure où elle ne modifie pas leur propre fonctionnement. L’enfant handicapé doit faire lui-même les efforts d’adaptation ou le quitter. Les situations où l’enfant doit rester à l’écart du groupe se répètent, situations imposées par une incapacité objective, mais parfois purement vexatoires. Les enfants qui grandissent avec des handicaps physiques, et cela n’est pas propre à la polio, pour peu qu’ils aient été bien soutenus, se sont le plus souvent construits une forte personnalité, habitués à donner plus d’eux-mêmes pour faire comme les autres.
2.4
Seconde rupture de cordon
Lorsque la période de croissance est sur le point de s’achever, corsets, appareillages et chaussures orthopédiques, encombrants, inesthétiques, rappelant sans cesse à soi-même et aux autres la présence de la différence physique, seront autant que possible (et même au-delà) mis au placard ! L’abandon de l’appareillage a été parfois possible au prix de quelques acrobaties physiques et prises de risque volontiers assumées. Sur une scoliose marquée qui a nécessité pendant toute la croissance le port d’un corset particulièrement contraignant, puis une fixation chirurgicale, la libération des contraintes est le plus souvent enfin possible. C’est une période clé, seconde rupture de cordon ombilical, celui qui relie de force au milieu médical et familial.
L’enfant devenu adulte a pu mener une activité professionnelle souvent très soutenue, malgré ou à cause du handicap, la femme a souvent pu mener ses désirs de maternité sans complication particulière. Nombreux auront ainsi pu mener une vie active sans jamais recourir au milieu médical jusqu’à ce que se posent des questions embarrassantes : chutes, perte de force, traumatisme déstabilisant un équilibre fragile, arthrose d’articulations surmenées… Pour d’autres, moins chanceux, la vie émaillée de problèmes de santé divers les aura obligés à ne jamais couper complètement le cordon de santé qui les lie à la médecine. Car avoir eu la polio ne met évidemment pas à l’abri de subir toute autre maladie. En outre, l’intrication des conséquences des paralysies post-poliomyélite et des autres problèmes de santé est constante. La poliomyélite ne s’oublie pas et malheureusement sera trop souvent accusée de tous les maux, parfois par facilité ou par méconnaissance.
Pourtant, paradoxalement, beaucoup ne parviennent pas à « couper le cordon » avec des pratiques anciennes et le comportement de nombre d’entre eux s’apparente bien souvent à un « refus » ou à une « impossibilité » de grandir : le kinésithérapeute n’est jamais compétent parce que différent de ce qu’ils ont vécu à l’âge de dix ans, l’appareilleur est toujours un incapable et le médecin ne connait rien au sujet…
2.5
Dégradation fonctionnelle tardive
L’angoisse de vivre une dégradation physique est naturellement présente. La dégradation physique due au vieillissement n’est pas toujours facile à accepter, d’autant qu’elle conduit parfois à poser de nouvelles indications d’appareillage. Reprendre un appareillage de membres inférieurs peut en effet être indispensable pour permettre la marche sans risque de chute, de fatigue ou d’altération articulaire exagérée. Les appareils d’aujourd’hui sont heureusement plus légers que les « cuirs/métal » d’antan, mais ils sont toujours contraignants et stigmatisants pour certains. À côté de la prescription d’un appareillage de novo, une des difficultés principales est de faire comprendre à ces personnes que la rééducation à 60 ans est nécessairement différente de celle qui leur a été imposée dans l’enfance : le renforcement moteur se pratique différemment, les mesures d’économie ont une place au moins aussi importante que le travail musculaire… Ils reviennent vers nous avec beaucoup d’appréhension, retrouvent des éléments familiers dans notre langage et notre façon de les examiner mais ne comprennent pas nos recommandations qui se démarquent complètement de ce qui leur a été inculqué dans l’enfance.
La dégradation qui serait due à une réviviscence de la maladie est, quant à elle, une inquiétude nouvelle, entretenue par les connaissances et les incertitudes du SPP. Elle conduit probablement à surestimer la fréquence du SPP, la plupart de ses symptômes n’étant, encore une fois, pas spécifiques. Que revient-il à la poliomyélite, au mode de vie, à la constitution physique naturelle, à un nouveau problème de santé ou au vieillissement ? Cette question doit être systématiquement étudiée devant chaque patient.
Mais lorsque les contraintes dans l’enfance ont été lourdes, cette confrontation à nouveau nécessaire avec le milieu médical, ce retour à l’hôpital dans lequel reste le souvenir d’une enfance particulière, éveille des émotions fortes et angoissantes. Confiance et appréhension sont souvent mêlées. Le premier contact humain après 30, voire 40 ans, peut être décisif. Revivre l’examen clinique détaillé tel « qu’on le faisait dans le temps », avec le testing musculaire et la goniométrie articulaire peut renvoyer à un vécu insupportable.
2.6
Conclusion
S’il existe des traits communs aux patients porteurs de séquelles de poliomyélite, il faut bien sûr se garder de proposer tout schéma simpliste. La poliomyélite est responsable de paralysies, toujours différentes d’une personne à l’autre. Elle n’est qu’un des paramètres ayant contribué à construire le psychisme de la personne.
Dans les formes sévères, le souvenir de trop longues années passées en scolarité encadrée par le milieu médical, du handicap marginalisant l’enfant dans le groupe et celui de contraintes physiques majeures est toujours vif. Les douleurs physiques et psychiques, profondément ancrées, font parfois redouter à l’extrême toute intervention médicalisée. Derrière les plaintes exprimées par le patient, les craintes et souffrances de l’enfance ne sont jamais loin. L’espoir et la méfiance mêlée à l’égard du corps médical peut faire mal interpréter certains comportements.
Il faut du temps, écoute et connaissances pour démêler, si possible, les différentes composantes des symptômes de fatigue et de douleurs. Inciter ces personnes à faire un travail sur elles-mêmes est souvent utile. Le bon choix entre les traitements (rééducation, appareillage, médicaments, chirurgie) ou l’abstention parfois nécessaire, en dépend.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree